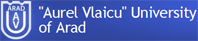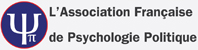Mondialisation, immigration et les nouvelles dynamiques identitaires
Simona Bealcovschi (Université de Montréal, Canada)
Résumé
La migration implique le chevauchement d’une série de facteurs locaux et globaux, de meme que des dimensions publiques ou intimes, libérales ou traditionnelles, hostiles ou favorables, qui se heurtent l’une a l’autre dans un processus souvent contradictoire et toujours émotionnel. A l’instar des théories postmodernes et postcoloniales, cet article examine quelques questions qui encadrent les dynamiques du Soi et de l’identité en connexion avec le phénomene des migrations féminines, dans le contexte de la mondialisation et de la mobilité récemment rehaussée des femmes. Il explore la construction de l’identité qui se définit ainsi en fonction de plusieurs temporalités et surtout en fonction des zones géopolitiques réelles ou imaginaires qui incorporent l’altérité. Il examine également les épiphénomenes de l’immigration et porte attention a plusieurs dynamiques identitaires, comme le métissage culturel et l’ambivalence, l’estime de soi et l’autonomisation (empowering) ou la fragilisation psychique.
Mots clé: mondialisation, immigration, identité, Soi, temporalité, métissage culturel
Summary
Migration brings together a series of local and global dimensions, as well as intimate and public spaces, liberal or traditional cultures and ideologies, and welcoming or hostile spaces. These factors are often in contradiction with one another, and transform migration into a highly charged emotional process. Inspired by theories of postcolonialism and postmodernity, this article examines several aspects of the dynamics of the self and of identity processes, especially as these involve the migration of women, whose social and cultural mobility has been dramatically affected by globalisation. In particular, I focus on the temporal dimensions involved in identity processes, as well as on changes to the real or imagined geopolitics of space that have redefined alterity. I also examine several epiphenomena attached to migration, such as cultural hybridity, identity ambivalence, self-realisation and individual empowerment, and psychological fragilisation.
Key words: globalisation, immigration, identity, Self, temporality, cultural hybridity
Introduction
A l’heure de la mondialisation et de la mise en place du nouvel ordre mondial néolibéral, ou les systemes de production et de finance sont rapidement et souvent inexplicablement déménagés d’une région a l’autre, de meme que les mutations économiques et sociales qui les accompagnent, on note des ajustements profonds autant au niveau du mouvement des capitaux que de celui des ressources humaines et culturelles. On assiste ainsi a un phénomene d’internationalisation globale signalé par une porosité aigüe des frontieres nationales, par un flux migratoire sans précédent, en Europe, en Amérique du Nord, et en Asie. On assiste aussi a une forme de «compression of time and space» (1), comme si la porosité des limites territoriales avait également brouillé la division entre «le passé» et «le présent» dont dépendent traditionnellement les identités nationales et meme individuelles.
Ces dynamiques entraînent des mutations jadis impensables au niveau du métissage de l’espace de la culture, générant de nouvelles représentations spatiales et identités hybridées. L’ethnicisation de certains quartiers au cour des plus grandes métropoles occidentales, par exemple, en est un signe de meme que les «nouvelles identités transnationales» et leurs pratiques de projection psychique ou d’identification nostalgique avec le passé ou avec le lointain, comme le nouveau cosmopolitisme de la classe moyenne occidentale. Cependant, ces signes d’ouverture vers l’Autre, vers le différent, et meme vers l’exotique, ne sont pas uniquement dus a la présence des immigrants mais aussi aux essais de la classe moyenne professionnelle dont le cosmopolitisme (2), récemment adopté, semble suggérer qu’elle tente de récupérer et de renforcer du capital social et culturel affaibli par les flous de la mondialisation. De moins en moins capable de contrôler le local, elle érige un simulacre du global.
Ces développements peuvent etre perçus comme une tentative de définir une alternative «cosmopolite » ou comme une réaction qui cherche a réinventer le «traditionnel» (dans le sens de Hobsbawm (3)) pour faire face a une invasion étrangere. Dans les deux cas, il s’agit de nouvelles formes d’hybridité qui ignorent les dynamiques traditionnelles et polarisées qui, jadis, traçaient les contours du contrat social en Occident : culture individualiste versus culture communautaire, culture nationaliste versus culture étrangere, société d’accueil versus société d’origine.
Face a ces changements dans les sociétés occidentales, il n’est pas surprenant que les immigrants soient inconfortables ou confus face aux valeurs ambivalentes de la société d’accueil, malaise qui ne fait qu’accroître les difficultés classiques entourant l’intégration (perte de statut social, obligation d’accepter un travail sous-qualifié, ghettoisation culturelle, obligation de se frayer un chemin dans un social inconnu et hautement individualisé, etc.). Autrement dit, les problemes «normaux» des immigrants sont aggravés par le contexte de la mondialisation et du néolibéralisme voués a affaiblir les cadres traditionnels et a déraciner les individus de leurs communautés de référence. Dans ce sens, la mondialisation a changé les enjeux de l’immigration, transformant la culture, soit celle de la société d’origine ou celle de la société d’accueil, en champs minés, car ni les valeurs traditionnelles ni les valeurs «nouvelles» ne sont plus capables d’encadrer le processus d’accueil et d’intégration.
Cet article tente de s’adresser a quelques questions qui entourent les dynamiques du Soi et de l’identité en connexion avec le phénomene des migrations féminines dans le contexte de la mondialisation et des nouvelles mobilités des femmes. Il explore quelques corrélations qui s’établissent entre l’acte d’immigrer et les épiphénomenes qui en découlent et qui influencent les changements et les définitions identitaires, surtout les conditions de l’émergence des formes de métissage et d’ambivalence culturelle indicible. Je me concentre empiriquement surtout sur les femmes immigrantes car elles sont une catégorie plus apte a subir des pressions dans les situations d’inégalité sociale ou politique.
Survol théorique
Les nouvelles théorisations et courants critiques qui émergent dans les années 1980 sont directement influencés par les effets de la mondialisation, incluant l’immigration économique. Les critiques postmodernes, postcoloniales, féministes ou des Études culturelles proposent en fin de compte un dépassement de la vision occidentale eurocentrique du monde et une redéfinition du sujet humain et de son identité, autant sur le plan théorique que méthodologique et se concentrent sur des concepts tels que : la déterritorialisation de la souveraineté, la fragmentation du Soi, la fragilisation des catégories jadis standardisées, l’entre-deux et le métissage, l’agir dans les espaces étatiques interstitiels, et l’émergence des cultures transnationales. Le concept de l’altérité, utilisé dans les sciences sociales pour théoriser le processus d’exclusion ou de subordination des individus ou des groupes différents d’un modele social normalisé dans le cadre d’une opposition cartésienne entre des « Nous » et des « Autres » bien définis, est présentement réactualisé et remis en analyse dans le contexte mondialisé ou l’écart culturel censé les séparer n’est plus clair.
Il y a quelques décennies, Simone de Beauvoir introduisait la femme dans l’arene théorique de l’altérité a l’intérieur d’un «Nous» dominé par une culture masculine. C’est donc a cette époque qu’émerge l’étude des dynamiques identitaires des catégories minoritaires subalternes qui ne sont plus simplement des «Autres» tout court mais qui sont une partie intégrale de la communauté. Gayatri C. Spivak, par exemple, avec son texte «Les subalternes peuvent-elles parler ?» (4) présente une nouvelle approche. Empruntant de Gramsci le concept de «subalterne» et s’éloignant aussi de la vision de Beauvoir, centrée sur les inégalités du patriarcat, Spivak y ajoute la domination de l’eurocentrisme et souligne le double «statut subalterne» des femmes du Tiers-Monde, fragilisées autant par leur condition féminine que par la vision géopolitique qui transforme l’individuation en simple épiphénomene du nouveau régime financier.
Dans un contexte différent, Foucault mettra au point sa théorisation du pouvoir ambivalent (5), qui privilégie «le sujet opprimé» qui devient «l’absent non représenté» forcément obligé d’agir individuellement et de tenter de parler pour lui-meme. La théorie de Foucault, centrée sur la normalisation des structures du pouvoir par rapport a la corporalité, va offrir de nouvelles clés pour analyser le pouvoir dans un contexte contemporain ou les lignes de force sont apparemment cachées par la rhétorique démocratique et par l’ouverture néolibérale.
D’autres concepts comme ceux d’«hybridité», d’«ambivalence» (6) ou de «tiers espace» émergent dans les critiques de Homi Bhabha (7) pour qui l’hybridité culturelle serait fluide et fragmentée. L’hybridité culturelle de Bhabha serait également une stratégie du pouvoir car, dans le contexte du postcolonialisme, les individus sont porteurs d’identités subalternes ; ils peuvent donc facilement assumer et manipuler de multiples identités. La construction de l’identité peut donc se définir en fonction de plusieurs temporalités «traditionnelles» ou «avant-gardistes» et surtout en fonction de plusieurs zones géopolitiques réelles ou imaginées, comme le propose Anderson (8), dont elles tracent les contours d’une intersubjectivité basée sur l’«altérité du Nous».
Ces perspectives novatrices, sensibles a la subjectivité autant qu’a l’«objectivité» du positivisme scientifique, répondent aux nouvelles réalités qui transforment le monde : la fin des empires, la fragilisation des États-Nations et de leurs «métarécits» (9) et l’accélération d’une mondialisation qui amene dans son cortege de nouveaux acteurs comme le migrant économique, l’ethnique, le transnational, le cosmopolite et l’individu a identité hybridée. Ces réflexions sur l’individu et sa relation avec la corporalité locale et la communauté globale nous renvoient aux théories qui placent le sujet au centre de la construction de l’habitus mais aussi aux carrefours de la fragilisation du Soi social.
Le passé et le présent ; L’immigration comme conflit identitaire
Partant de la prémisse que l’identité se construit dans un mouvement double, autant par rapport au Soi intime que par rapport aux autres, nous nous sommes intéressés dans cet article a examiner succinctement quelques dynamiques identitaires dans le contexte de l’immigration féminine contemporaine en Europe et au Canada.
Dans mes recherches préliminaires réalisées sur l’immigration au Canada (10), j’ai comparé les dynamiques identitaires de deux groupes de femmes migrantes afin d’établir les mécanismes psychiques et les indicateurs qui étaient a la base des stratégies de définition identitaire dans le contexte migratoire. Le premier groupe était constitué des femmes migrantes de l’Europe de l’Est qui travaillaient dans les pays occidentaux de l’Union européenne; le deuxieme groupe était constitué de femmes immigrées au Canada avec leurs familles, dont la majorité provient des pays de l’Europe centrale et de l’Est. Dans cet article, nous allons nous référer uniquement a trois des indicateurs considérés dans notre recherche, soit, le rôle du paradigme temporel dans la définition identitaire, la performance autonome et l’altérité. Cette étude transversale a révélé, par exemple, que par rapport au paradigme temporel, les migrantes économiques qui travaillent en Europe développent plus rapidement l’estime de soi que les immigrantes déménagées en Amérique du Nord car elles ont tendance a voir leur déplacement dans un monde étranger comme un séjour et non comme un changement permanent qui les obligerait a s’intégrer dans le pays d’accueil. L’étude a aussi révélé que les immigrantes de l’Amérique du Nord, a différence des migrantes d’Europe, sont plus aptes a incorporer des identités métissées et aussi qu’elles démontrent une performance autonome supérieure, tenant compte de leurs acquisitions basées non seulement sur leur capacité d’adaptation mais surtout sur leur capacité de transformation.
La migration temporaire est le plus souvent liée a un projet économique familial de courte durée qui se réalise dans un délai rapide. Les femmes restent attachées a leurs projets et motivations originelles pendant que leurs familles demeurent «chez elles». Bref, elles investissent dans un futur bien défini qui ne les obligerait pas a redéfinir leur identité sociale et intime et ne les forcerait point a formuler des stratégies pour affronter les questions de perte (de statut, de la parenté, des amis, des réseaux d’entraide, etc.).
Les migrantes temporaires travaillent pour des périodes fixes (une saison ou quelques années) et envisagent de retourner dans leur pays d’origine. Ceci est facilité par le fait que la majorité des pays de l’Union européenne ont des politiques plutôt flexibles face aux migrantes d’origine européenne et, les voyages touristiques se transforment souvent assez facilement en séjour de travail clandestin, les femmes occupant souvent des emplois domestiques ou sous-qualifiés. Approximativement deux tiers des femmes étudiées ont travaillé pour des périodes de plusieurs années (surtout en Italie et en Allemagne); elles retournaient plusieurs fois par année dans leur ville natale et conservaient un contact régulier avec la parenté et les amis restés au pays. Ceux-ci, a leur tour, effectuaient des visites le plus souvent a l’occasion des fetes religieuses de Noël et de Pâques ou pendant les vacances. Ce systeme de visites réciproques était possible grâce aux couts bas du transport (souvent il s’agissait de petites lignes de transport routier organisées spécifiquement pour faciliter tels voyages). Le fait de retourner au pays pour les Fetes renforce la condition «temporaire» de leur séjour car les Fetes font un appel sémiotique a un ensemble d’émotions incorporées (embodied) qui sont intégralement arrimées dans l’imaginaire de la société d’origine. Les Fetes sont un symbole d’une temporalité figée dans un passé traditionnel partagée par la communauté entiere, donc un point de référence stable de leur ancrage identitaire.
De plus, le fait que souvent les femmes se déplaçaient seules, transportant différents biens, marchandises ou cadeaux, a renforcé simultanément leur pouvoir d’agir et l’autonomisation. Cette circulation, sans nécessairement etre commerciale, a néanmoins mené a une reconsidération du rôle des femmes par rapport aux lieux et aux espaces censés les définir. Si jadis leur culture patriarcale limitait traditionnellement les espaces publics de l’agir féminin, désormais elles font plus facilement le saut entre le privé et le public, le local et le lointain. Souvent, elles ont du assumer des attitudes «masculines» et agressives pour affronter et déjouer toutes les formes de contrôle policier et douanier qui pourrait les intimider ou confisquer les biens et les documents de voyage. Ces femmes se sont aussi valorisées a travers une nouvelle présentation du soi, ritualisée dans le sens goffmanien (11), avec un accent mis sur la performance corporelle métropolitaine comme nouveau lieu d’identification formelle (de nouvelles attitudes, une nouvelle présentation vestimentaire, de nouveaux stéréotypes linguistiques attestant un passage superficiel d’une culture a une autre, de nouveaux gouts culinaires, etc.).
A différence de ce groupe, les femmes immigrées au Canada ont du affronter un processus beaucoup plus complexe de reconfiguration identitaire, car l’immigration est une rupture a tous les niveaux et implique autant l’esprit, la mémoire et l’affect que la corporalité dans tout ce qu’elle a de plus biologique par ses rapports au climat, a la nourriture, aux typologies des soins de santé, aux pratiques corporelles, etc.
La question de l’intégration des immigrants est conçue généralement comme une étape positive qui se réalise, par exemple, au Québec par le biais des politiques d’accueil spécifiques mises en place a travers des programmes gouvernementaux qui visent a harmoniser l’écologie sociale. Au Canada, pays qui a investi dans le développement des politiques et d’infrastructures d’immigration, l’accueil des immigrants s’effectue a travers des ensembles législatifs visant : 1. l’intégration administrative, territoriale et surtout sociale (les structures d’accueil parrainées par le gouvernement); 2. l’intégration économique (insertion par le travail); et 3. l’intégration linguistique (en fait, les immigrants au Québec sont obligés de maitriser deux nouvelles langues, le français et l’anglais).
L’intégration est aussi envisagée comme un «contrat moral» accepté par les immigrants pour leur insertion dans une société démocratique et pluraliste, dont les deux valeurs primordiales sont : 1. Le principe de laicisation de l’État, censée représenter le respect d’autres religions et cultes et 2. L’individualisme, valeur sociale essentielle dans la société nord-américaine, car elle est le véhicule censé garantir la différence identitaire (12).
Cependant, le mécanisme d’intégration est loin d’etre spontané et mécanique, car les sociétés d’accueil occidentales se présentent de façon contradictoire : d’une part, elles incarnent l’ouverture, l’espoir et la liberté ; d’autre part, leur hypermodernité a éliminé la plupart de catégories temporelles qui servent a orienter le Soi intime. Dans ce sens, l’étape d’intégration serait liée avant tout a un processus complexe de décodage, d’incorporation et de maîtrise de systemes de représentation a la lumiere d’une dynamique temporelle postmoderne. L’extension spatiale, signalée par un systeme d’échange hyperactif, a éliminé le passé et le futur comme points de référence pour la construction du Soi. Comme Bhabha le note (13):
The present can no longer be simply envisaged as a break or a bonding with the past and the future, no longer a synchronic presence: our proximate self-presence, our public image, comes to be revealed for its discontinuities, its inequalities, its minorities.
L’identité contemporaine se présente comme étant fluide, hybridée et réalisée dans le présent. Elle est aussi négociable, justement par l’entremise des mécanismes d’empowering individuel (14) et par son rejet de l’identité historique inventée par l’État-nation, devenue la force des traditions nationales des peuples modernes. Elle se présente aussi comme une identité «libérée» ayant réfuté l’essentialisme des anciennes catégories organisationnelles:
To move away from the singularities of ‘class’ or ‘gender’ as primary concept-ual and organizational categories, has resulted in an awareness of the subject position- of race, gender, generation, institutional location, geopolitical locale, sexual orientation- that inhabit any claim to identity in modern world.
What is theoretically innovative, and politically crucial, is the need to think beyond narratives of originary and initial subjectivities and to focus on those moments or processes that are produced in the articulation of cultural difference. These ‘in-between’ spaces provide the terrain for elaborating strategies of selfhood-singular or communal- that initiate new signs of identity.
The very concepts of homogenous national cultures, the consensual or contiguous transmission of historical traditions, or ‘organic’ ethnic communities – as the grounds of cultural comparatism – are in a profound process of redefinition. (ibid).
Face a cette fluidité, une bonne parte des migrantes se définissent justement par leur référence a leur identité antérieure encadrée par des structures nationales ou ethniques et par des traditions, éléments qui leur conferent stabilité et un ancrage spatio-temporel. Une rupture avec le passé peut devenir une source d’angoisse car il est difficile de se situer quand on n’a plus de reperes temporels. L’isolement temporel culturel de l’immigrante est alors vécu comme une mort symbolique, car il n’existe a ce moment de début que deux alternatives ; soit celle du repli, soit celle de l’ouverture et de l’empowering. En tant qu’immigrante, la femme laisse un milieu culturel qu’elle maîtrise et entre en confrontation avec un monde régi par un systeme de significations inconnues dont le sous-texte la pousse vers un anéantissement symbolique. Le nouvel environnement néolibéral a rejeté les bases patriarcales traditionnelles de la définition identitaire féminine: les femmes ne doivent plus ni dépendre, ni se définir vis-a-vis les hommes, un fait, qui fait partie de l’« ideascape » (cf. Appadurai) canadien. Dans ce sens, beaucoup de femmes provenant des cultures traditionnelles (patriarcales) éprouvent une baisse d’estime de soi car leur identité de «femme traditionnelle» n’est plus valorisée a l’heure de la libération de la femme, conçue comme une condition sine qua non du Soi individuel autonome. Cette période d’intégration (15), dont la durée varie en fonction de la capacité de la femme de prendre le pouvoir et d’agir, est la période de la nostalgie et de la reproduction mécanique du mode de vie antérieure. Le malaise psychique devient une lutte temporelle et renforce le lien avec le passé imaginé, fait qui, évidemment, ralentit le processus d’insertion dans le présent.
Cependant l’intégration, n’est pas uniquement une étape de conciliation avec soi-meme. Elle se développe au fur et a mesure que les immigrantes recomposent des liens sociaux et incorporent autant les nouvelles définitions de l’altérité que de nouveaux systemes de signification. Le grand défi identitaire devient la lutte pour négocier les différences entre les deux temporalités des deux sociétés et de concilier le passé de la société d’origine avec le présent éternel de la société d’accueil.
Le mécanisme d’intégration est donc ambivalent, il est public et privé, social et intime et renvoie aux aspects invisibles et polysémiques de la définition identitaire dominée par des catégories comme la mémoire, la langue maternelle, la nostalgie, etc. Les dynamiques de valorisation ou de fragilisation et de perte peuvent agir de maniere cumulative, renforçant ou affaiblissant le Soi, selon le contexte. L’ambivalence provient justement de la fusion qui se réalise entre l’incorporation de l’altérité dans les structures déja naturalisées dans notre identité originelle. Comme le notait une de mes interlocutrices:
Pour les Fetes de Pâques on a acheté l’agneau de Québec, ça vient des fermes locales, soit tu vas chez les Arabes de Jean Talon tu sais. Je n’aime pas l’agneau de la Nouvelle-Zélande!
Ensuite la teinture des oufs je l’ai pris du magasin des Russes (mieux que la teinture du magasin allemand et moins cher), j’ai acheté un «cozonac» chez les Polonais, et voila, on a bu notre propre «tzuica» venu directement de Roumanie avec ma mere, et voila, on s’est bien organisé… Ah, oui, oui, bien sur qu’on est allé a l’église, nous allons a l’Église orthodoxe grecque de Jean Talon… Et en plus, ma mere elle a fait aussi des «cozonaci» et du «drob», mais bien sur, on le fait chaque année, meme si les gens ici ne fetent pas les Pâques comme les orthodoxes…
Comme ça on se sent bien ! On respecte la tradition meme si on est dans un autre coin du monde; on le fait pour nous, on les fait pour les enfants et pour les nouveaux amis d’ici qui ne connaissent pas nos traditions… mais ils les adorent. Ça fait du bien ! (CM. 46 ans, institutrice).
Conclusions
Dans cet article nous nous sommes proposé d’explorer quelques dynamiques du Soi et des technologies identitaires dans le contexte de la mondialisation en nous référant particulierement aux migrantes non occidentales déplacées dans des cultures postmodernes.
Nous avons tenté de souligner qu’en dépit de tout paradigme économique, la définition identitaire des migrantes/ immigrantes est un phénomene complexe a la fois individuel (psychologique) et social collectif défini par des structures sociohistoriques et délimitées par des catégories culturellement construites, comme le temps et l’espace, le domaine public et privé, les rôles des genres, etc. Ces structures de la géopolitique du Soi influencent le développement transitoire des identités, leur hybridation ou leur refus de changer, mais aussi le renforcement du micro-individualisme ou la fragilisation sociale dans les zones de transition car les immigrantes sont prises entre deux systemes de représentations et de valeurs. D’une part, l’hypermodernité – ou les références au passé ne servent pas d’ancrage symbolique ; d’autre part, les valeurs incorporées dans la société originelle. En meme temps, les immigrantes vont devenir plus aptes a incorporer une forme d’altérité qui désormais fait partie de la réalité quotidienne postmoderne. Cette dynamique nouvelle, d’une identité qui transgresse les frontieres culturelles et incorpore la diversité, ne fait qu’augmenter son individualité.
Compte tenu des exemples présentés, nous pourrions donc conclure qu’en dépit de toutes les circonstances contradictoires et difficiles qui accompagnent l’immigration, l’expérience transnationale et «trans-temporelle» influence la dimension identitaire féminine par l’imposition d’une nouvelle trajectoire d’autonomisation et surtout par la nécessité de maîtriser de nouvelles formes de valorisation et d’affirmation du Soi.
Endnotes
(1) Harvey David. (2000). Spaces of Hope. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
(2) Par exemple, les communautés culturelles alternatives attachées a des cultes et religions étrangeres; les pratiques «New-Age», les bistros et les boutiques d’alimentation exotique etc.
(3) Hobsbawm Eric J. (1983). Nations and Nationalism since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.
(4) Spivak C. Gayatri, Paris. (2009). Les subalternes peuvent-elles parler?. Éd. Amsterdam.
(5) Foucault Michel (1983). “The subject and Power”. Afterword to Hubert Dreyfus & Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Stucturalism and Hermeneutics, Chicago: The University of Chicago Press.
(6) Young J.C. Robert. (1995). Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London and New York: Routledge. Selon Young, «l’ambivalence est un mot-clef pour Bhabha qu’il emprunte a la psychanalyse, ou on l’utilise tout d’abord pour décrire une fluctuation continuelle entre vouloir une chose et son opposé (…). En faisant de l’ambivalence le centre de son analyse, Bhabha a eu fait effectuer un revirement politique a un niveau conceptuel, par lequel la périphérie, le cas limite, le marginal ou l’individu inclassable est devenu “l’ambivalence équivoque”, incertaine et imprécise qui caractérise le centre».
(7) Bhabha Homi. (1994). The Location of Culture. Paris: Éditions Payot.
(8) Anderson Benedict. (1991). Imagined Communities. London: Verso.
(9) Lyotard Jean-François. (1979). La condition postmoderne: rapport sur le savoir. Paris: Éditions de Minuit.
(10) Recherche réalisée dans le cadre d’un projet postdoctoral a l’INRS-UCS (Institut national de la recherche scientifique, Centre — Urbanisation, Culture, Société), Université du Québec, Canada.
(11) Goffman Erving. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. New York, Doubleday-Anchor, Garden City.
(12) Laaroussi M., Montejo M.E., Lessard Dd., Viana M. (1995). Les pratiques sociales au Québec. NPS, Vol. 8 No 2, p. 125.
(13) Bhabha H. The Location of Culture. p. 6.
(14) Concept lié a l’autoestime dans le sens qu’il confere un orgueil personnel, une sensation de «pouvoir faire» (comme son nom l’indique, provenant de l’anglais power) ; il est par conséquent inévitablement lié au niveau d’autovalorisation d’un individu, mais également a l’agir (agency). Voir: Rappaport J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward a theory for community psychology. American Journal of Community Psychology. 15: 121-148.
(15) Par exemple, selon Laaroussi et al… (1995) qui ont étudié le processus d’intégration des femmes immigrantes dans la région d’Estrie, il y a trois types de stratégies de reconstruction identitaire :
1. Les stratégies de repli, «dans lesquelles les femmes se retirent dans l’invisibilité, dans la nostalgie et dans le privé et utilisent l’informel comme moyen de protection identitaire».
2. Les stratégies de revendication, «qui permettent aux femmes d’user de leur visibilité nouvelle et du formel du pays d’accueil pour revendiquer leur différence tant par rapport au pays d’origine qu’au pays d’accueil».
3. Les stratégies de négociation, «qui articulent le formel et la visibilité dans des ajustements situationnels».
Ces stratégies correspondent a des étapes différenciées d’empowering et réorganisent autant les rôles familiaux et les représentations des femmes sur eux-memes que les attitudes envers l’extérieur (p.130).